Homélie du 20 janvier 2019, 2ième dimanche ordinaire,
prononcée au temple de Dijon dans le cadre de l’échange de chaire entre l’Église Protestante Unie de Dijon et la paroisse catholique de St Joseph.
Prière d’illumination :
Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté.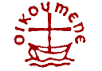
Fais taire en nous toute autre voix que la tienne.
Et, pour que nous sachions entendre ta Parole, mais aussi la recevoir, la connaître, mais aussi l’aimer, l’écouter, mais aussi la mettre en pratique,
Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité,
Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Lecture de Jean 2, 1-11
méditation
Nous venons donc de lire dans l’évangile de Jean les noces de Cana. Nous connaissons bien cet événement de la vie du Christ situé chez Jean mais pas dans les autres évangiles. Chez Jean, à l’opposé, on ne trouve nulle trace des rois mages, comme chez Matthieu, nulle trace des bergers, comme chez Luc, nulle trace donc de ces personnes, de haute ou de petite condition, qui viennent se recueillir au pied du nouveau-né. Par contre, on découvre – et je dirais presque « à la place » – un repas de noces. C’est une autre épiphanie, une autre manifestation de la divinité du Christ, que nous présente alors la communauté johannique : il s’agit de la reconnaissance de la gloire de Jésus par ses disciples.
Au 3ième jour de la vie publique du Christ, comme nous le précise le texte, on assiste au commencement des « signes » de la vie publique du Christ. L’identification de ce 3ième jour marque symboliquement un jour de plein accomplissement des choses, comme le sera celui du passage de la mort à la résurrection. En ce 3ième jour, durant les noces de Cana, l’eau devient vin, comme à Pâques, par le Christ, la mort deviendra vie.
Ce premier signe du Christ se déroule donc au cours d’un repas et prend la forme d’un service. Jésus rend service à sa mère qui lui adresse une demande, il rend service aux organisateurs de la noce à court de vin. Il ne s’agit donc pas ici, dans l’action du Christ, de quelque chose de vital, d’indispensable : personne n’est en danger, personne ne souffre de maladie. Jean ne parle alors pas de miracle mais bien de signe. Cet événement est un signe car il parle d’autre chose que de lui-même : il dit quelque chose de Jésus, il dit que Jésus est « l’agneau de Dieu » que Jean-le-Baptiste annonce. Et les disciples ne s’y trompent pas, ils crurent en lui après avoir vu cet évènement, comme nous le dit le texte.
Chez Jean, ce repas du début de la vie publique du Christ fait écho à celui de la fin de sa vie, c’est-à-dire à la sainte cène. Contrairement aux autres évangiles, nous ne trouvons pas chez Jean, au cours du dernier repas, d’institution du partage du pain et du vin. Non, chez Jean au moment de ce dernier repas, le Christ se lève, se ceint d’un linge, s’agenouille devant ses disciples et leur lave les pieds. Il se fait serviteur. Il se fait, par amour du Père et des hommes, le plus petit d’entre eux.
C’est ce sens du service et cette urgence à découvrir le véritable amour de Dieu pour les hommes qui parcourent l’évangile de Jean. Les repas sont des moments de fête où est célébrée la vie. Ces repas du début et de la fin de la vie publique du Christ sont donc des moments qui disent et instaurent un passage et une transformation pour la vie. Le Christ va passer de la vie privée à la vie publique, de la mort à la vie. Ces repas racontent des événements mais en même temps ils nous disent comment suivre le Christ.
Le texte de ce jour nous parle d’une transformation qui est en même temps un devenir, un mouvement vers du mieux. Il y a un avant et il y a un après. Il y a une situation qui est problématique – le vin manque – et qui se trouve résolue par une action – celle du Christ qui va faire rassembler par les serviteurs l’eau dans les vases de purification des juifs, et ensuite la faire puiser, un fois transformée en vin, pour la servir aux convives. Et qui plus est, ce vin nouveau se trouve être meilleur que celui servi jusqu’à présent au court de la noce.
L’eau se transforme en vin, le manque se transforme en abondance, le bon se transforme en meilleur : le vin déjà bon, celui qui est digne d’être servi à une noce, est remplacé par du vin encore meilleur. Ce vin nouveau est celui de la bonne nouvelle de Jésus Christ. On trouvera chez l’évangéliste Marc cette référence au vin nouveau qui doit être enfermé dans des outres neuves. Suivre le Christ conduit à mettre en œuvre des pratiques religieuses et de vie différentes de celles des juifs contemporains du Christ.
Mais cette transformation n’affecte pas que le vin : elle touche aussi les personnes. Visiblement c’est par Marie que l’invitation de Jésus et de ses disciples à la noce semble s’être opérée. Elle est le pivot de l’affaire mais, pour autant, pas le centre de l’action. Le texte nous dit sobrement que la mère de Jésus est là, et que Jésus et ses disciples ont aussi été invités à la noce. Jean nous dit que la mère de Jésus – qu’il n’appelle d’ailleurs jamais par son nom – est une présence. Il nous dit qu’elle est là, comme il nous dira aussi qu’elle est là au pied de la croix au moment de la crucifixion.
Dans le texte de ce jour, c’est une présence active dont il s’agit puisque Marie suit ce qui se passe à cette noce et voit que le vin vient à manquer. Elle anticipe le déshonneur qui peut tomber sur la famille qui accueille en n’étant pas à la hauteur de son devoir de régaler les convives au cours d’une fête digne de ce nom. Elle voit ce qui se passe pour les autres, les hôtes, et intervient auprès de celui qui lui est proche, son fils, pour qu’il agisse. Elle fait comme nous le ferions si nous voyions une situation délicate arrivée et que nous savions que notre enfant pouvait la résoudre. Nous lui demanderions s’il ne veut pas intervenir puisqu’il en a la capacité, voire même nous le presserions de le faire.
Il s’en suit un échange étrange où Jésus rabroue sa mère par ces mots : « Femme que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue ». On dirait aujourd’hui, en termes courants, que Jésus envoie gentiment balader sa mère comme on le ferait avec un parent qui aurait une attitude jugée, à ce moment-là, trop intrusive par rapport à notre vie personnelle. Un rapport et bienveillant entre personnes, nous le savons bien, les amène parfois à préciser ce qu’est le cadre de leur relation. Deux choses bonnes semblent se heurter dans cet échange : d’un côté, ce souci de Marie pour la famille organisatrice de la fête et, d’un autre côté, ce qui semble être la bonne heure pour Jésus pour manifester pleinement qu’il est le fils de Dieu. Ce moment de manifestation ne dépend pas de Marie, mais du Père.
Il s’opère alors une double transformation dans le sens où le Christ va effectuer ce qu’il n’aurait pas voulu faire et où Marie ne va pas faire ce qu’elle aurait voulu réaliser. On assiste ainsi en direct à un équilibrage dans la relation entre Jésus et sa mère, équilibrage qui dit en même temps qui est pleinement Jésus et qui est pleinement Marie. Marie, la femme transformée par le regard que Dieu a posé sur elle, est fidèle aux paroles dites à l’ange de l’annonciation : « voici la servante du Seigneur ; que m’advienne selon ta parole ». Marie, après la réaction du Christ, en confiance, se met en retrait de l’affaire en disant aux serviteurs d’effectuer ce que Jésus leur dira. Jésus, d’une certaine façon lui aussi en confiance, en se laissant guider par les événements, accepte de passer discrètement au centre de l’affaire. Il dit aux serviteurs de remplir les jarres et les jarres sont remplies et leur eau devient du vin.
Jésus répond à la demande qui lui est adressée mais son acte ne semble pas être claironné sur tous les toits. Il ne devient pas le centre de la fête : c’est les mariés qui le demeurent… et ils ne sont pas au courant de ce qui vient de se passer. Qui sait alors ce que Jésus vient d’accomplir ? Le texte laisse entendre qu’il ne s’agit que des serviteurs qui ont réalisé le travail, de ses disciples qui sont avec lui et de sa mère. Et que produit son geste ? La croyance en lui de ses disciples. Ils voient sa gloire.
Le Christ fait donc à ces noces de Cana ce qu’il ne pensait pas faire et pourtant il le fait. Il va agir comme avec la cananéenne de la région de Tyr qui vient le supplier avec insistance de guérir sa fille. Comme nous le raconte Matthieu, après l’apostrophe qui lui est adressée, dans un premier temps, il ne veut pas répondre à la cananéenne mais va tout de même finir par le faire. Il agit en voyant la foi de ceux qui lui parlent. Sa mère Marie est femme de foi, la cananéenne est femme de foi. L’une et l’autre lui font une demande qui ne correspond pas à la façon dont il souhaite que les choses se déroulent. Et pourtant à l’une et à l’autre, il répond. Par l’une et par l’autre, il se laisse transformer comme l’eau en vin, et il découvre ainsi mieux qui il est. Pour l’amour des hommes et comme modèle des hommes, il entre profondément en service.

