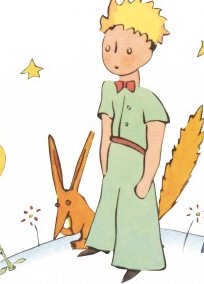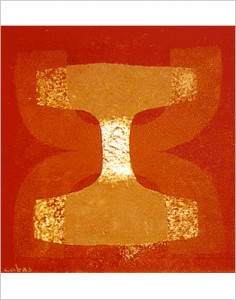HOMELIE du 26 août 2018
par Claude Compagnone, Diacre
Jos 24, 1-2a.15-17.18b ; Ps 33 (34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23 ; Ep 5, 21-32 ; Jn 6, 60-69
Dieu veut que nous soyons des hommes libres. Ce que les textes de Josué et de St Jean disent, c’est précisément le choix qui est laissé aux hommes de suivre le vrai Dieu ou de ne pas le suivre.
Les tribus d’Israël réunies à Sichem ont le choix de suivre, soit le Dieu d’ici, c’est-à-dire le Dieu des Amorites dont ils habitent le pays, soit le Dieu d’avant, celui que leurs pères servaient de l’autre côté de l’Euphrate, soit leur Dieu qui les a fait sortir d’Egypte. Ils choisissent alors le Dieu d’ici et maintenant, dont ils ont fait la rencontre, en le suivant pour sortir d’Egypte et fuir l’esclavage de Pharaon.
Les tribus d’Israël vont s’exclamer « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres Dieux. (…) C’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin. (…) Nous aussi nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu ». Les tribus d’Israël devant le choix que leur soumet Josué, proclament leur foi et leur engagement envers leur Dieu.
Josué est le successeur de Moïse. C’est lui qui installe les tribus d’Israël dans le pays de Canaan, puisque Moïse est mort en arrivant à la terre promise, mais sans pénétrer cette terre. Au soir de sa vie, au moment où il sait qu’il va partir, Josué est pris par
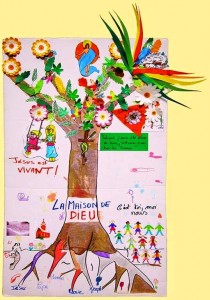
l’urgence de voir son peuple, dont il est le guide, assumer pleinement son engagement envers le Dieu de la liberté et de la vie.
Trois fois dans ce chapitre du livre de Josué, le peuple va affirmer vouloir servir son Dieu. Pour marquer cet engagement Josué, l’inscrit dans le livre de la loi de Dieu et dresse une grande pierre dans le sanctuaire du Seigneur. Il en fait quelque chose de solennel. L’événement est crucial : les tribus ne peuvent pas suivre Dieu par habitude, par routine ou par obligation. Dieu les a voulus libres, et c’est à eux de vivre pleinement cette liberté en suivant ou pas librement Dieu.
Il en va de même des disciples du Christ. Les voici qui, dans la partie finale de ce long chapitre 6 de l’évangile de St Jean, disent au Christ, « Elle est rude cette parole ! Qui peut l’entendre ? ». Mais quelle est donc cette parole si rude qu’elle fait fuir les disciples ? Ses disciples demandent au Christ un signe qui va leur permettre de voir et de croire, ils veulent qu’il accomplisse une œuvre. Ils s’attendent à ce que quelque chose de grandiose arrive pour pouvoir le croire.
Ils viennent de vivre la multiplication des pains. Ils voient de la puissance en Jésus Christ et en attendent encore plus. Et sa réponse les déçoit profondément. Le Christ leur affirme tout simplement qu’il est « le pain vivant descendu du ciel » et que « si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ». Quelle déception pour eux ! Rien de grandiose, mais un homme qui affirme qu’il est la vie, qu’il est le fils de Dieu et qu’il se donne aux hommes. Rien de tout cela n’est audible pour eux, ce n’est pas ce qu’ils veulent entendre. Il leur dit qu’il est la vie et cela, ils ne peuvent pas le croire, cela ne leur suffit pas. Ils ne voient pas Dieu ainsi… Ils tournent alors les talons et s’en vont !
Les apôtres, eux, vont rester. Et comme Josué pose la question aux tribus d’Israël de savoir quel Dieu ils souhaitent suivre, Jésus, en pleine crise de confiance de ceux qui l’ont suivi jusqu’à présent, pose le même genre de question aux apôtres : « Voulez-vous partir vous aussi ? ». Les apôtres sont alors placés devant un choix libre et conscient. En ce moment de crise, où tout se délite, où les disciples fuient car insatisfaits, les apôtres pourraient s’en aller, eux aussi, sans que cela n’ait un grand coût social pour eux. Bien au contraire, on les trouverait bien raisonnables de s’éloigner de cette personne, Jésus, qui s’affirme le fils de Dieu, tout simplement à travers ce qu’il est et la manière dont il se comporte avec les gens. Nulle armée, nulle bataille, nul triomphe, ici. Non, seulement, un homme simple qui vit pleinement sa relation à Dieu et aux hommes, et qui dit être le chemin de la vie.
Au début de l’évangile de St Jean quand les deux premiers disciples rencontrent Jésus et que celui-ci leur pose la question « Que cherchez-vous ? », ces deux disciples lui répondent alors par une autre question : ils lui demandent « Où demeures-tu ? ». La réponse de Jésus est « Venez et vous verrez ». Dialogue étrange, où personne ne répond directement à personne, mais où les choses sont dîtes, comme si le Christ leur avait répondu « vous voulez me suivre ? Et bien suivez-moi ! ». Et les disciples partent à sa suite.
Maintenant, dans le texte de ce jour, quand la plupart des disciples s’enfuient, nous ne sommes plus au début. Et là, la question de Jésus adressée à ses apôtres est : « Voulez-vous partir vous aussi ? ». Et les apôtres réaffirment leur choix premier maintenant qu’ils connaissent mieux le Christ. Ils lui répondent à nouveau par une question : « Seigneur, à qui irions-nous ? », et proclament leur foi : « Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu ». Ils disent qu’en tant qu’hommes libres, ils choisissent la vie. Et que par ce choix, et face à tout ce qu’ils peuvent connaître, suivre le Christ s’impose à eux parce qu’il est précisément la vie, la vie de Dieu.
Dans notre vie de chrétiens, certains moments nous amènent à réaffirmer notre engagement de chrétiens. Il y a des moments ritualisés où nous redisons notre foi comme dans les célébrations sacramentelles. Mais il y aussi ces moments de crise où nous sommes poussés à prendre position. Là, il nous faut dire notre foi ; nous n’avons pas le choix ; il y a urgence. Des crises notre monde en vit, et il nous faut urgemment prendre position, redire que nous voulons suivre le vrai Dieu.
Si vous avez suivi l’actualité de cet été, vous voyez comment la crise écologique, et le réchauffement climatique qu’elle entraine, s’imposent à nous. Laisserons-nous dégrader la création sans changer de mode de vie ? Nous sommes en tant que chrétiens responsables de cette création ! Vous voyez aussi comment le sort des migrants est traité, d’une manière qui n’est pas tenable. Imaginons que notre pays soit ravagé par je ne sais quelle catastrophe chimique, biologique ou nucléaire, comment souhaiterions-nous être accueillis ailleurs ? De la même manière ?
Enfin, au sein même de notre Eglise, nous voyons comment des formes d’emprise destructrice sur des enfants de Dieu ont pu se produire du fait, selon les mots mêmes de notre Pape, du cléricalisme qui peut y régner. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes au service les uns des autres : nul n’est supérieur à l’autre. En réaffirmant notre foi en Christ, nous avons l’urgence et le devoir, chacun d’entre nous, de faire vivre une Eglise humble, joyeuse et fraternelle.
homélie du 19 août 2018
par Francis ROY, diacre
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui ». Notre esprit rationnel d’aujourd’hui nous pousse à interpréter ces paroles de Jésus : « ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson » comme des paroles symboliques. Et personne n’imagine sérieusement une discussion, à la sortie de la messe, sur le parvis de l’église, entre paroissiens autour de la question des juifs : « comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? ». Bien sûr qu’il n’est pas question ici de cannibalisme ! Notre compréhension ne doit évidemment pas s’arrêter à cette image trop concrète ; elle doit aller au-delà et plutôt chercher la signification de ces paroles.
A la lumière de la Résurrection, puis de la Pentecôte, les apôtres vont comprendre ces paroles de Jésus non pas comme symboliques, mais comme prophétiques. Jésus parle de son corps donné en vraie nourriture, lui qui va véritablement donner sa vie ; de son sang comme vraie boisson, lui qui va verser son sang sur la croix. Ce que Jésus dit, il l’applique d’abord à lui-même ; il le met lui-même en pratique. Ses actes parlent autant que ses paroles, et viennent les compléter, les éclairer, les expliquer. Quand il donne son corps, ce n’est pas qu’une image, qu’une façon de parler. Il ira jusqu’au bout de ce don : « Ma vie, nul ne la prend : c’est moi qui la donne ». Et ce don de lui-même, Jésus le fait par amour.
Ce qui est frappant dans cet Évangile, c’est que le Christ n’essaie en rien, devant le scandale des juifs, de rattraper ses paroles. Il n’essaie pas de « calmer le jeu ». Et si le Christ agit ainsi, n’est-ce pas pour que les hommes de tous les temps sachent bien que dans l’Eucharistie il n’est pas que symboliquement présent, mais réellement, charnellement. Oui, l’Eucharistie, c’est un don réaliste et charnel du Christ : il donne réellement son corps et son sang à consommer. Quand nous communions, notre corps touche le corps sacré du Christ. Oui, notre chair (c’est-à-dire notre personne, car nous sommes notre corps) entre ainsi en contact avec la chair du Christ, donc avec toute la personne du Christ ressuscité.
L’Amour de deux époux s’exprime dans le réalisme charnel des gestes de l’amour. L’Amour de Dieu pour l’homme a cherché aussi à s’exprimer charnellement, car l’homme est charnel. Ceux qui s’aiment se surprennent parfois à dire dans un élan d’amour : je t’aime tellement que je te mangerais ! Eh bien, Dieu a réalisé ce désir de l’amour : s’ils m’aiment, ils me mangeront ! Seul l’Amour peut expliquer cette folie, l’Eucharistie est le baiser charnel du Christ et de l’homme. Et prudes sont en définitive, ceux qui ne voient dans l’Eucharistie qu’une vague présence symbolique. Au risque de choquer, il est bon de remarquer que les paroles que nous disons en accueillant le Seigneur sont les mêmes que celles que se disent les époux qui se donnent dans leur grand geste d’amour : Voici mon corps livré pour toi. Je suis tout à toi.
En laissant les juifs décontenancés, sa catéchèse semblait connaître l’échec. En fait, cet échec nous est précieux, pour nous aider à croire à la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Il nous est assez facile de comprendre qu’une mère ou un père accepte de donner sa vie pour sauver un de ses enfants. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Si le don de nos vies peut parfois permettre de sauver une personne, et c’est très beau, Jésus, lui, donne sa vie, donne son corps, pour sauver non pas une personne, mais l’humanité entière. Lorsqu’il nous arrive de donner un peu de notre sang, peut-être allons-nous permettre de sauver une vie, et c’est magnifique. Jésus, lui, a versé son sang pour sauver la totalité de nos vies humaines.

C’est pourquoi il ne nous est pas absurde de le remercier ! Or, qu’est-ce que l’eucharistie ? C’est justement le« merci » de l’humanité à son Sauveur pour le sacrifice de sa vie. Eucharistie, action de grâce, au cours de laquelle, en mangeant son corps, nous « rendons grâce », en remerciement de la grâce, du cadeau gratuit qui nous est fait par ce don de Jésus. C’est le psaume 33 que nous avons chanté tout à l’heure : « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres ». Et la lettre de St Paul aux Éphés
iens reprend en écho : « A tout moment et pour toute chose, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Cette attitude de remerciement, ce n’est pas une simple politesse qui nous est demandée. C’est un moyen pour vivre en harmonie avec Dieu, et donc avec nous-mêmes et avec les autres, avec la Création tout entière. C’est ce que la Bible appelle la Sagesse. C’est le bon sens, l’intelligence toute simple.
Reprenons la lettre de St Paul dans la deuxième lecture : « ne soyez donc pas irréfléchis ; ne vous enivrez pas, laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit Saint » Comment mieux se laisser remplir par lui qu’en mangeant son corps ? Le passage du livre des Proverbes, dans la première lecture, nous le disait lui aussi : « Si vous manquez de sagesse, venez à moi ; venez manger mon pain et boire le vin que j’ai préparé. Quittez votre folie et vous vivrez, suivez le chemin de l’intelligence ». Ces appels au bon sens, à la sagesse, à l’intelligence véritable, nous invitent à cette vie en pleine harmonie. Harmonie rendue possible par le don total de Jésus qui, en nous donnant son corps en nourriture, sous la forme aussi fragile que ce tout petit morceau de pain, nous montre ce qu’est le véritable amour : L’amour est don total, don fragile et humble, mais don qui se fait nourriture capable de rassasier toute notre vie.
Si vous êtes très attentifs au texte de l’Évangile vous verrez que le mot qui revient le plus est le mot Vie : pain vivant, il vivra éternellement, pour que le monde ait la vie, vous n’aurez pas la vie en vous, vous aurez alors la vie éternelle, celui qui mange ce pain vivra par moi, etc…
L’Eucharistie, c’est le pain de la vie présente, le pain de la route, la nourriture du voyage qui nous réconforte et nous empêche de connaître l’inanition spirituelle sur la route de la Terre promise. C’est le pain partagé entre tous les migrants en route vers Dieu.
Mais l’Eucharistie, c’est aussi, inscrit en notre corps de chair, le germe de notre Résurrection : Oui, ce corps qui a touché, reçu, assimilé ce corps charnel du Christ ressuscité, sera donc lui aussi promu à la résurrection. La mort sera vaincue quand, à notre tour, ces germes feront jaillir ce corps renouvelé, ce « corps spirituel », qui nous sera donné à la fin des temps.
Amen.
Marie, notre mère…
MARIE, SACREMENT DE LA TENDRESSE DE DIEU
L’amour maternel de la Très Sainte Vierge, qui est incomparable, qui est unique, qui nous enveloppe tous personnellement, nous appelant chacun par notre nom, cet amour nous révèle l’Amour maternel de Dieu, puisqu’il en procède.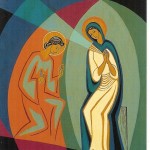
Tout ce qu’il y a de maternité dans le cœur de Marie jaillit du Cœur de Dieu, qui est encore infiniment plus maternel qu’elle-même; et justement, pour que nous apprenions que Dieu est notre Mère, que nous le connaissions au féminin, pas seulement au masculin, car Dieu est aussi féminin qu’il est masculin, comprenant dans son éminence tous les aspects de l’Être.
Marie nous révèle Dieu au féminin. Elle nous révèle la maternité de Dieu. Elle nous permet de prier Dieu au féminin, comme une maman
Maurice Zundel
Sainte vierge Marie, Apprenez-nous à aimer le silence.
Apprenez-nous à aimer le silence des champs aux étendues immenses, le silence des grands bois recueillis, le silence des nuits étoilées et sereines.
Apprenez-nous à aimer le silence des églises où Jésus, inlassablement, nous attend, et où dans l’intimité de son amour, nous pouvons écouter sa voix discrète et amicale raffermir nos âmes et reprendre courage.
Sainte vierge Marie,
Apprenez-nous à aimer le silence comme vous l’avez aimé, à le pratiquer comme vous l’avez pratiqué.
Apprenez-nous l’art de nous taire et l’art de parler.
Remplissez nos vies de silence, ô Notre Dame,
Et nos silences, d’amour pour vous, pour notre prochain et pour Dieu.
SAINT BERNARD
HYMNE : HEUREUSE ES-TU, VIERGE MARIE

Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur,
tu cries de joie à l’ombre de ses ailes.
Sainte Mère de Dieu,
prie pour nous, pauvres pécheurs.
HYMNE : NOUS TE SALUONS, VIERGE MARIE
Nous te saluons, Vierge Marie, servante du Seigneur.
Ta foi nous a donné l’Enfant de la promesse,
la source de la vie.
Ève nouvelle, montre-nous le Sauveur, Jésus Christ, notre frère,
Sainte Mère de Dieu.
HYMNE : SOUS L’ABRI DE TA MISÉRICORDE
Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse
19° dimanche de l’Année B VENIR A DIEU QUI VIENT
1° Livre des Rois, chap. 19, 4-8
Psaume 33 / 34
Lettre de saint Paul aux Éphésiens, chap. 4,30 à 5,2
Évangile de Jean, chap. 6,41-51
Deux personnages font compagnie à Jésus en ce week-end. Et tout est placé sous un marqueur : le verbe VENIR. C’est la colonne vertébrale de ces récits.
Moïse accompagne tout le chapitre 6 de St Jean que nous entendons ce mois-ci. C’est l’homme de la libération, l’homme qui fait passer au désert pour que l’on devienne libre, qui guide et supporte son peuple, et le prend en charge devant son Dieu. Son ministère est d’aider le peuple à rencontrer le Seigneur Dieu comme un ami rencontre un ami. Il fait advenir le face à face. Grâce à lui nous est venue l’Alliance éternelle.
L’autre grande figure nous est proposée par la première lecture. C’est le prophète Élie, l’homme à la parole énergique et efficace, celui qui fait venir la sécheresse pour stigmatiser l’infécondité du peuple, celui qui a contraint le peuple à comprendre que son Dieu à lui est le seul Dieu auquel on puisse adhérer. Mais en affirmant cela, il s’oppose au roi Akhab, qui est un minable, et à la reine Jézabel, femme épouvantable de pouvoir. Il découvre la vanité impuissante qu’il y a à ne compter que sur soi-même — c’est l’épisode que nous venons d’entendre — jusqu’au moment où il fera abandon de ses prétendues forces pour laisser parler en lui le souffle printanier d’un Dieu qui est une promesse de germination, promesse d’un avenir.
Là, c’est Dieu qui vient jusqu’à lui. Puis qui le fait aller vers les humains.
Or il se trouve que Moïse et Élie tenaient compagnie à Jésus lors de la fête du début de cette semaine, lundi, quand nous célébrions la Transfiguration de Jésus, quand Jésus a manifesté à ses amis son visage de lumière.
Et bien, dans ce que Jésus nous dit tout de suite du pain et du vin, quand il nous dit sa présence en eux, nous sommes témoins de sa filiation avec nos grands prophètes, de sa fraternité avec eux. Nous contemplons l’intensité de son énergie.
Jésus se donne à fond pour donner vie à la foule des gens qu’il aime. Il leur donne la nourriture et la boisson dont ils ont vrai besoin, comme un germe de vie en plénitude.
Moïse et Élie, et Jésus, ce sont des êtres d’épanouissement, de route vers une existence réussie. Ils sont animés par un souffle que toute le la Bible ancienne avait appelé l’Esprit de sainteté et nous venons d’entendre l’apôtre Paul le nommer simplement l’Esprit avec une majuscule.
L’Esprit qui pousse les gens les uns vers les autres pour qu’ils s’entendent.
L’Esprit qui est ce Dieu à qui l’on peut faire une peine infinie en refusant d’avancer, en refusant de sortir de soi-même, en refusant de faire une rencontre.
L’Esprit est le souffle fragile que l’on peut refuser de recevoir en soi quand on refuse de recevoir l’autre — le frère ou l’inconnu, ou même l’inconnu qui est en nous.
L’Esprit de Dieu, l’Esprit de Jésus, l’Esprit de sainteté… Il nous prie humblement de bien vouloir communier à ce don de lui-même que Jésus nous fait quand il prend dans ses mains notre terre, et qu’il offre dans sa coupe débordante le vin de nos vignes.
Jésus vient « de là-haut » ; l’Esprit fait venir les humains les uns vers les autres. C’est le mouvement de Jésus qui se répercute au niveau terrien / terrestre.
Le pain et le vin en reçoivent une autre signification, l’Esprit de Jésus leur accorde une autre dimension. Ils sont eux-mêmes transfigurés. Ils signifient maintenant autre chose qu’eux-mêmes. Ils font espérer que toute réalité humaine et toute réalité matérielle de notre terre et de notre sol pourront un jour signifier autre chose que ce que l’on voit en superficie — je dirais même volontiers : autre chose que leur dureté et que leur résistance solide –.
Le pain et le vin transfigurés sont habités par une réalité qui vient de bien plus profond et qui va bien plus loin que tout ce que l’on peut croire : grâce à eux on peut envisager sérieusement que tout dans l’humain et tout dans le terrestre soit habité par une largeur, une longueur, une profondeur, une dimension que l’on ne soupçonnait pas (c’est saint Paul lui-même qui prend cette image d’un espace en expansion infinie pour parler de l’amour). Très exactement, c’est lorsque toute réalité sera épanouie de cette façon-là que l’on pourra parler de résurrection et de Dieu tout en tous.
La transfiguration du pain et du vin nous enseigne donc à considérer autrement les choses humaines, et à considérer Dieu autrement. Si la vie de Dieu vient transmuer les choses humaines, c’est que Dieu n’est pas le tout-puissant immobile et lointain : s’il est pain et vin que l’on reçoit, cela veut dire que Dieu est humilité et service. Si l’ordinaire banal de la vie et des activités humaines sont transfigurés, c’est que l’espérance a gagné et que la vie éternelle n’attend pas demain. Aucune réalité terrestre n’est que ce qu’elle a l’air d’être. Le terrestre est bien plus grand qu’il ne paraît : il peut venir au jour puisque l’Amour lui est venu.
Si vous en êtes d’accord, venez communier tout à l’heure.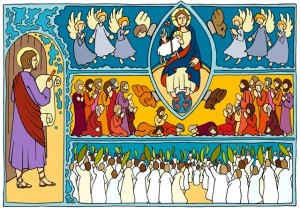
Dieu vient vers vous, venez vers Dieu.
Communiez, communiez toujours.
Laissez-vous pousser par l’Esprit.
Ne rendez pas tristes vos frères.
Ni Dieu.
père dominique nicolas
LA MANNE ! AH ! LA MANNE !
Livre de l’Exode, chap. 169
Psaume 77/ (78)
Lettre de Paul aux Ephésiens, chap. 4
Évangile de Jean, chap. 6
La manne, ah ! La manne ! On voudrait bien savoir ce que c’est ! Quelle est sa composition physico-chimique comme disait le médecin de notre équipe de liturgie. « Qu’est-ce que c’est » disent les gens – mann hou ?
Les hypothèses sont nombreuses : elles vont de la sève d’un tamaris du désert jusqu’à des petits papillons. La Bible ne nous explique pas ce que peut bien être cette fine couche , légère comme du givre, ressemblant à de la graine de coriandre, ayant le goût d’un gâteau de miel…
La Bible ne dit rien de ce qu’elle est, mais beaucoup de la façon dont elle fonctionne. Ce qui semble assez moderne : nous aurons la définition en son fonctionnement , et si nous y participons.
D’abord, la manne est la réponse d’un Dieu qui a entendu la détresse de son peuple. Elle est comme une bouée de sauvetage qui va les soutenir jusqu’au jour où ils sauront nager tout seuls. —C’est-à-dire quand ils arriveront en terre promise où ils auront à travailler.
Elle a valeur de test :
parce que, d’abord, ils ont la nostalgie du bon vieux temps où ils étaient assis, et où leurs marmites se remplissaient. Maintenant, ils auront à sortir pour récolter leur nourriture. Première fonction : la manne est un appel. ; elle teste notre liberté et notre capacité à nous sortir …
Deuxième fonction : ceux qui en récoltaient beaucoup n’en avaient pas trop pour autant, et ceux qui en ramassaient peu ne manquaient tout de même pas. La manne se personnalise, à chacun selon ses besoins. Et l’on ne pouvait pas en faire de réserve, sinon pour le jour de chabbat, puisqu’on ne s’occupe de rien de matériel ce jour-là. Cette nourriture qui vient quotidiennement du ciel ne peut s’amasser dans des greniers. On ne peut pas en prendre pour la stocker ou la revendre. C’est un pain quotidien, et il faut avoir confiance qu’il arrivera encore demain et après-demain. Donc double fonction : c’est l’anti-accumulation , l’anticapitalisme, l’anti-peur du lendemain, et l’affirmation que Dieu seul est dieu.
Instrument de libération, la manne teste si nous avons juste jugement et juste décision.. Et teste notre capacité à garder cœur libre et tête haute, envers et malgré tout. Nous ne sommes riches que d’une question : qu’est-ce que c’est ?
Et puis , enfin et surtout, elle vérifie si nous avons une juste relation avec le ciel d’où elle nous vient : en elle, Dieu se fait pain-qui-se-mange, co-pain, littéralement : notre compagnon.
En fait, la vraie nourriture, c’est le point d’interrogation ; notre énergie est de nous interroger. La juste et vraie solidité humaine est de recevoir réponse des com-pagnons de nos routes. Ceux avec qui nous avançons, malgré tous les déserts.
Et d’un en particulier, qui a pour nom Jésus.
Les braves gens de l’évangile qui s’épuisent à courir de tous les côtés, n’en finissent pas de le chercher, de le harceler de questions. Il veut calmer leurs peurs et leurs angoisses. Ils se cherchent quelqu’un qui les comblerait, lui leur indique la montagne et les sommets de silence où il part. il leur indique où est la plénitude, il leur dit où il puise son énergie. Il propose un chemin de libération dans sa façon d’être.
Comme prophétisait Job, Jésus « sait en qui il a mis sa confiance ». Son compagnon de route omniprésent est ce Père dont il invite à discerner la présence en tout. Jésus n’en finira pas de dire « Apprenez à juger », « apprenez à voir juste ». Ne vous trompez pas sur vous-mêmes. Ne vous trompez pas sur Dieu ni sur autrui. Ce n’est pas votre passé qui vous fait, — la résurrection qui vous vient, votre à-venir, c’est cela votre vie.
La vie de Jésus est un signe, un appel à chercher ce qui est derrière la lourde porte des apparences, un appel à s’interroger— comme font ces enfants, que Jésus donne toujours en modèle quand les adultes se croient des grandes personnes. Quand les adultes sont pleins d’eux-mêmes, càd pleins de vide…
Jésus appelle à sortir de nos vacuités, de nos enflures, de nos fausses évidences, pour arriver à la Terre de la Promesse : il donne son énergie, se donne corps et âme, livre toute sa vie.
Il n’y a de tonus qu’en Jésus et sa manière d’être. En Lui, nos vitamines du matin (comme il se disait avec les enfants de la 1° ciommunion).
AMEN
Sagesse (16,20-21.25-26)
ce n’est pas la production de fruits
qui nourrit l’homme,
mais bien ta parole qui fait subsister ceux qui croient en toi…”